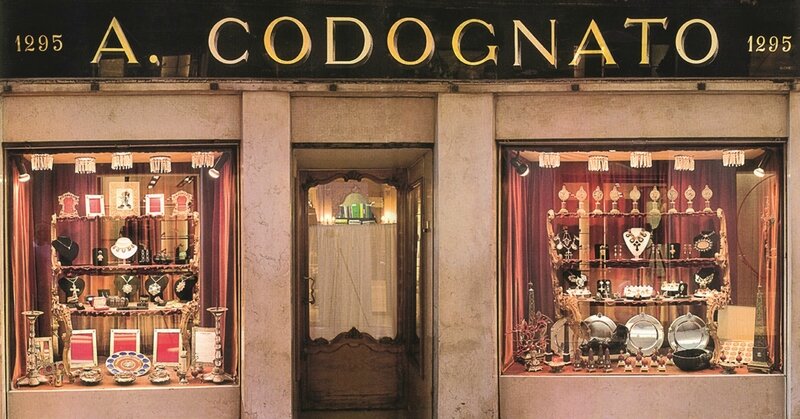Richard Racine nous offre ici le premier volet d’une série portant sur la toponymie régionale. Périodiquement, d’autres textes et des informations diverses sur le sujet vous seront présentés dans la catégorie « Toponymie, cartes et plans » du site internet de la SHHY. Pour ne rien manquer, visitez-nous souvent. MG

John Manners, Marquis de Granby (1721-1770). (Auteur: Sir Joshua Reynolds. Source: Ringling Museum of Art, Sarasota)
Sans qu’on en soit pleinement conscient, la toponymie joue un rôle de gardien de la mémoire locale en faisant constamment référence à un fait, un personnage ou à un lieu historique. À Granby, la double appartenance culturelle de la ville est mise en évidence par la concentration de noms de rues à consonance anglaise dans sa partie haute et à consonance française dans le secteur ouest, principalement dans celui que l’on nommait, au 19e siècle, le village français.
La période coloniale nous a donné, à partir de 1845, des généralités comme Main Stage Road et Main Street, pour la rue Principale, ou North Road pour la rue Elgin, puis une identification plus précise telle que Market Street, pour la rue Dufferin, Court Street et Forest Street, pour la rue du Parc, des lieux fréquentés par la société de l’époque.
En 1867, les autorités municipales comblent une lacune en ordonnant de « donner un nom à toutes les rues qui n’en possèdent pas encore. » Naturellement, on s’inspire de l’administration britannique pour choisir des noms comme Drummond, Dufferin et Mountain. Quelques années plus tard, la concentration de la population francophone, établie à l’ouest de l’église Notre-Dame, favorise l’apparition de toponymes religieux et des références à l’élite du temps. Pendant de nombreuses années, le clivage linguistique délimite la frontière géographique entre les deux communautés établies dans le « vieux Granby ». La nomenclature des rues attestant de cette réalité historique.

© Le boulevard Montcalm. Cette artère, qui date de 1926, portait à ses débuts le nom de Robert en l’honneur d’un homme d’affaires de Granby. En 1932, le conseil municipal lui attribue le nom du général français mort lors de la bataille des plaines d’Abraham, le marquis Louis-Joseph de Montcalm. À l'extrémité nord, le Centre hospitalier de Granby. (Collection SHHY, photo: La Voix de l'Est, vers 1950)
La prise en charge de l’administration municipale par la bourgeoisie francophone, à partir du début des années 1930, déclenche des transformations dans tous les secteurs de la société, incluant la toponymie. Alors que Pierre-Ernest Boivin achève son dernier mandat à la mairie s’amorce un virage dans l’attribution des noms de rues à Granby. Sans doute la poussée nationaliste de cette période y est elle aussi pour quelque chose, des artères comme St.James, Franklin et Huntingdon voient leur nom changé pour Saint-Jacques, avenue du Parc et Saint-Antoine. Les références à l’histoire nationale font aussi leur apparition. Les nouvelles rues Cartier, Laval et Brébeuf côtoient maintenant dans les registres les personnages locaux que sont les Boivin, Leclerc et Robert. Par la suite, on ajoute des références botaniques et autres fantaisies au répertoire toponymique.
L’attribution d’un odonyme qui rappelle soit un lieu géographique présent ou ancien, soit la participation d’un individu ou d’une famille au développement du territoire, soit l’importance d’un personnage politique fait maintenant partie des règles de gestion municipale. L’importance de la toponymie n’est plus à démonter puisqu’un organisme international comme l’UNESCO reconnaît son caractère patrimonial depuis 1987.
Richard Racine
Toponymie de Granby